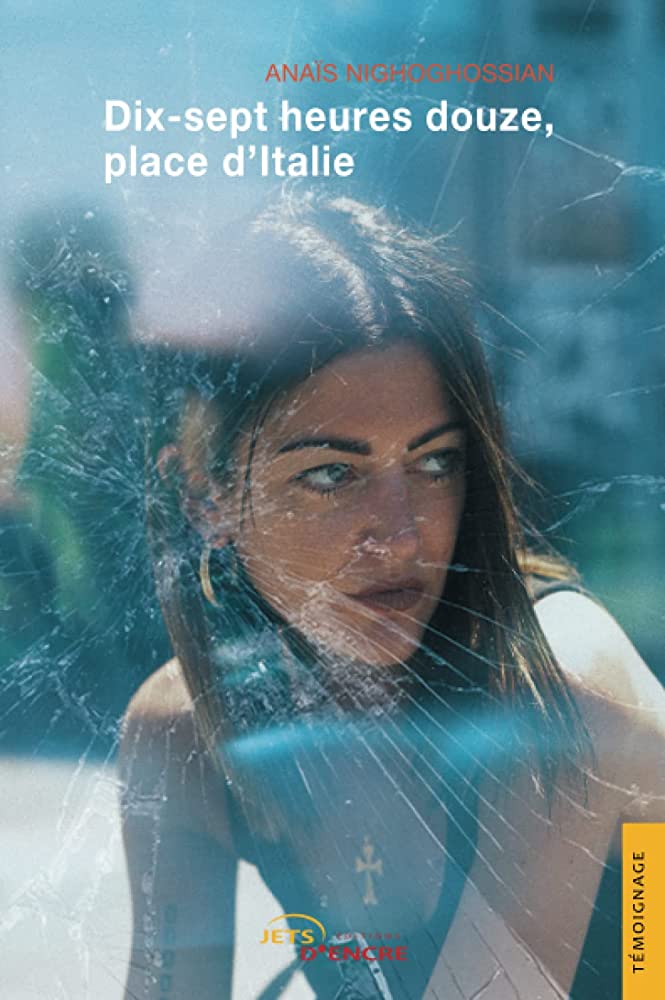Le vendredi 2 juin 2023 c’était la Journée mondiale de lutte contre les troubles des conduites alimentaires (TCA). À l’heure où de plus en plus de personnalités prennent la parole sur les TCA comme l’ex-mannequin et actrice Victoire Dauxerre à notre caméra ou encore Crazy Sally sur sa chaîne YouTube, j’ai à cœur de vous partager les regards croisés des auteur·ice·s Anaïs Nighoghossian et Mickaël Worms-Ehrminger issus de notre dernier live. Iels ont partagé leurs expériences des troubles des conduites alimentaires : des mécanismes aux solutions, en abordant également l’impact de ces troubles sur leurs rapports aux autres. Nous avons essayé de vous apporter les clés pour mieux comprendre et appréhender ce trouble qui est particulièrement mortel pour la santé mentale des personnes qui en souffrent.
ANAÏS, DANS TON LIVRE TU PARLES DES ROUAGES DE LA FABRIQUE DE L’IDENTITÉ ANOREXIQUE. D’APRÈS VOS PARCOURS RESPECTIFS, QUELS ONT ÉTÉ LES VÔTRES ?
Anaïs Nighoghossian : C’est une combinaison de plusieurs facteurs. Il ne s’agit pas d’incriminer ni la société, ni les médias, ni l’industrie de la mode ou de la beauté, ni même la forme d’éducation que j’ai pu recevoir. J’ai deux frères qui ont reçu la même éducation et eux n’ont pas connu de troubles psychiques ou mentaux. Les rouages de l’anorexie sont issus d’une dynamique plurielle.
Ce qu’on m’a dit à Sainte-Anne, c’est que tout d’abord il y a une prédisposition génétique. Tout dépend de la plasticité de votre cerveau. S’il est suffisamment plastique, nous sommes plus agiles et avons davantage la capacité à changer de schéma. Or dans l’anorexie, il y a une obsession de la rigidité. On peut se retrouver très vite enfermé·e dans un seul schéma.
Il y a aussi un conditionnement culturel. On ne pourra pas donner toutes les raisons aujourd’hui. Mais j’ai grandi dans une famille d’immigré·e·s orientaux il y a donc sans doute quelque chose qui relève d’une volonté d’intégration afin d’oublier le passé, une forme de mémoire collective un peu traumatique, qui fait que l’on va se fondre dans une certaine norme pour gommer toutes ses aspérités.
Mickaël Worms-Ehrminger : Pour ma part, ça va être la même chose qu’Anaïs. Il faut aller chercher du côté des facteurs biologiques, sociaux, psychologiques… C’est ce qu’on appelle le modèle psychosocial : il y a trois types de facteurs qui interagissent. Quand il y a un déséquilibre parmi ces trois facteurs, une maladie va apparaître.
Dans ma famille, il y a beaucoup d’anxiété. Moi, j’ai fait plusieurs épisodes dépressifs. Mon trouble des conduites alimentaires a débuté par une anorexie restrictive lorsque ma mère a eu un accident. Il y a eu ce déséquilibre familial au cœur d’un moment clé de l’adolescence : celui de la transition où il y a tous les basculements hormonaux, sociaux etc… En fait c’est simple, je rechute dans mon trouble du comportement alimentaire à chaque fois qu’il y a un événement traumatique.
Là, mon dernier épisode a eu lieu lors d’une grippe. J’ai perdu quelques kilos en un mois. Et j’ai commencé à aimer ça à nouveau. Je me pesais, je voyais les chiffres chuter, ça me faisait du bien. À chaque fois, il y a eu un déclencheur. Mais attention, il ne sort pas de nulle part. Il est nourri par des prédispositions, on peut y réagir de manière négative, ou pas. Cela dépend de tellement de facteurs différents. Comme l’a dit Anaïs, ses frères ont grandi dans le même milieu, avec la même éducation mais ils vivent les choses de manière complètement différente.
Je crois en tout cas qu’il y a un dénominateur commun : la composante addictive. Dernièrement il y a de nombreuses hypothèses qui émergent sur l’aspect addictif de la perte de poids, en tout cas pour l’anorexie. Elle serait davantage nourrie par l’addiction de voir son poids baisser plutôt que par la peur de grossir. Quand on a une addiction, c’est un cercle vicieux. On en veut toujours plus. Quand j’étais à 55 kilogrammes, je voulais atteindre les 54 etc. Il y a un véritable plaisir, on voit que ça marche en plus. On vit l’anorexie comme une réussite.
![]()
Léger comme une plume, sec comme un coup de trique, j’aime passer mes doigts sur mon sternum et sentir de chaque côté le bout de mes côtes saillantes que je caresse avec une excitation qui n’a rien de sexuel.
Mickaël Worms-Ehrminger, Vivre avec un trouble de santé mentale.
CETTE NOTION DE CONQUÊTE, DE RÉUSSITE, DE PERFORMANCE REVIENT DANS VOS DEUX TÉMOIGNAGES. JE TE VOYAIS RÉAGIR ANAÏS, EST-CE QUE TU ES D’ACCORD AVEC CE CÔTÉ PERFORMATIF DE L’ADDICTION ?
Anaïs Nighoghossian : Absolument. Moi je l’ai compris très tard mais c’est une approche assez nouvelle de la maladie. Lorsque j’ai 17 ans et que l’on m’interne dans une clinique psychiatrique, l’anorexie est d’abord une punition. C’est presque une double peine que l’on m’inflige en me mettant derrière les barreaux. Ce que je découvre à Sainte-Anne, qui d’ailleurs, héberge en son sein un service de sevrage pour toutes les typologies d’addictions, dont les troubles alimentaires, c’est qu’en réalité mon anorexie est une addiction. J’ai appris à me sevrer de la même manière que demain je pourrais essayer de me sevrer de la cigarette.
Je sais qu’aujourd’hui j’ai le choix de m’alimenter ou de ne pas m’alimenter pour rester clean. C’est aussi car j’ai d’autres leviers dans ma vie qui me font du bien me dire que « je mérite et que je veux rester en bonne santé » parce que j’ai trop souffert et que j’en ai payé le prix trop tard. Aujourd’hui, je choisis donc de m’alimenter. Je renonce, jour après jour, à mon addiction. Parce qu’effectivement c’est tentant. Par exemple, lorsque je sors le soir, je rentre d’une soirée, il est minuit, j’ai fumé, j’ai bu, je n’ai pas mangé, je rentre chez moi, pourquoi je mangerais, j’ai le choix : je peux manger ou je ne peux pas manger. Et c’est là que la question se pose et que finalement, à force de répétition, et comme n’importe quel·le toxico, on finit par s’éloigner petit à petit de l’addiction.
Une des approches, en plus de thérapies cognitives et comportementales, qui m’ont beaucoup aidé, c’est le groupe de parole. Il en existe pour les personnes souffrant de troubles alimentaires au même titre que les Alcooliques anonymes. C’est exactement la même chose. J’ai été aux Alcooliques anonymes des TCA pendant des mois. Ça en dit long sur cette question de l’addiction d’ailleurs. Mais j’aurais aimé le savoir plus tôt, même si je ne sais pas si j’aurais été plus réceptive. L’anorexie ce n’est pas juste une lubie, ce n’est pas juste un épisode. C’est une addiction, comme on peut être accro à la clope, au café, aux antidépresseurs.
ANAÏS, TU PARLES DANS TON LIVRE DE TES DEUX EXPÉRIENCES DE SOIN. IL Y A CETTE PREMIÈRE EXPÉRIENCE TRAUMATISANTE EN RAISON DU FLICAGE À LA CLINIQUE SAINT-VINCENT DE PAUL.
PUIS UN PEU PLUS TARD, UNE SECONDE EXPÉRIENCE QUI REPOSAIT NOTAMMENT SUR LA FORCE DU COLLECTIF DE CES GROUPES DE PAROLES. QUELS ONT ÉTÉ LES DÉCLICS LIÉS À CES DEUX ÉVÉNEMENTS ?
Anaïs Nighoghossian : La première hospitalisation, ce n’est pas un déclic, c’est un renoncement. C’est l’équivalent d’une hospitalisation à la demande d’un tiers. Je suis sur le point de rentrer en classe préparatoire et mon état physique ne suit plus. On décide pour moi. Je me laisse faire. Je sombre dans un enfer carcéral qui dure des mois, dont je vais sortir complètement marginalisée, déscolarisée. C’est un aspect du traitement par isolement sur lequel j’insiste dans le livre. Au-delà du trouble qui n’est pas résolu, ça laisse des stigmates sur notre estime de soi, qui est d’ailleurs généralement atrophiée lorsqu’on souffre de TCA. Je pense que j’ai passé 15 ans sans pouvoir l’évoquer, sans pleurer. C’est aussi une des raisons pour lesquelles j’ai eu besoin d’expier toute cette douleur dans ce livre parce qu’elle était incompréhensible. Nul ne peut se douter ce qu’il se passe à l’intérieur de ces murs.
![]()
Si l’anorexie m’a rendu mythomane, paranoïaque et fabulatrice, mon séjour à la clinique n’a fait qu’aggraver les choses.
Anaïs Nighoghossian, Dix-sept heures douze, Place d’Italie.
En revanche, pour ma deuxième expérience de soins, je viens d’avoir 30 ans. Le poids des années fait que j’en ai marre de continuer à mentir, d’essayer de me cacher. L’un de mes leviers principaux aussi fut la peur de mourir.
MICKAËL, TU PARLES AUSSI DANS TON LIVRE DE CE TYPE DE DÉCLIC. TU ÉVOQUES UNE CRISE PIRE QUE TOUTES LES AUTRES QUI TE FORCE À PRENDRE UNE DÉCISION : SE SOIGNER OU MOURIR. COMMENT PEUT-ON LUTTER CONTRE UNE TELLE DOULEUR POUR EN FAIRE UN DÉCLIC POSITIF ?
Mickaël Worms-Ehrminger : Je souffrais tellement physiquement et psychologiquement qu’il fallait que ça s’arrête. Progressivement, je suis sorti du déni en me disant que ce n’était pas normal, que personne ne faisait ça. Ce soir-là j’étais effectivement en crise suicidaire. Je suis donc allé aux urgences, je ne pouvais pas rester chez moi car il y avait trop d’affects négatifs. Ça a suivi son cours pendant quelques semaines et j’ai demandé une hospitalisation à Sainte-Anne dans le même service qu’Anaïs. J’ai fait une hospitalisation d’évaluation qui a duré 2 jours, où ils ont fait des tests biologiques, psychologiques etc. À la fin, on m’a également proposé de participer au groupe de parole mais c’était en pleine semaine. Je travaillais donc ce n’était pas possible. Puis ils m’ont proposé une hospitalisation de sevrage boulimique, qui ne s’est jamais faite alors que j’avais insisté pour la faire. On m’a aussi proposé un suivi avec un·e psychiatre spécialisé·e dans les TCA, mais c’était il y a 3 ans et j’attends toujours.
J’ai donc dû me débrouiller seul pour aller consulter. On sait qu’à Paris, les psychiatres sont extrêmement chers et il y a énormément de dépassements d’honoraires. Je suis donc allé dans un centre médico-psychologique où on peut consulter anonymement et gratuitement. Il y en a dans chaque ville en général. Mais la contrepartie est qu’on ne peut pas choisir son psychiatre ou psychologue. Comme c’est une spécialité qui est très humaine, il suffit que ça ne passe pas et tu sais que la thérapie peut mal se passer. Quand j’ai commencé, ça ne passait pas du tout. Mon psychiatre de l’époque me prescrivait des médicaments qui me provoquaient des crises de boulimie. C’était vraiment n’importe quoi, il allait à l’opposé des recommandations de prise en charge. Jusqu’au jour où je me suis dit que ce n’était plus possible. Si je continuais à le voir j’allais aller de mal en pis. J’ai donc trouvé une psychiatre en téléconsultation, qui n’est pas à Paris et qui a des tarifs normaux. Je la vois depuis un peu plus d’un an et demi. Je ne l’ai jamais vuE en vrai mais ça se passe super bien et on avance pas mal. Ce qui m’a aidé, c’est la thérapie, en plus des médicaments.
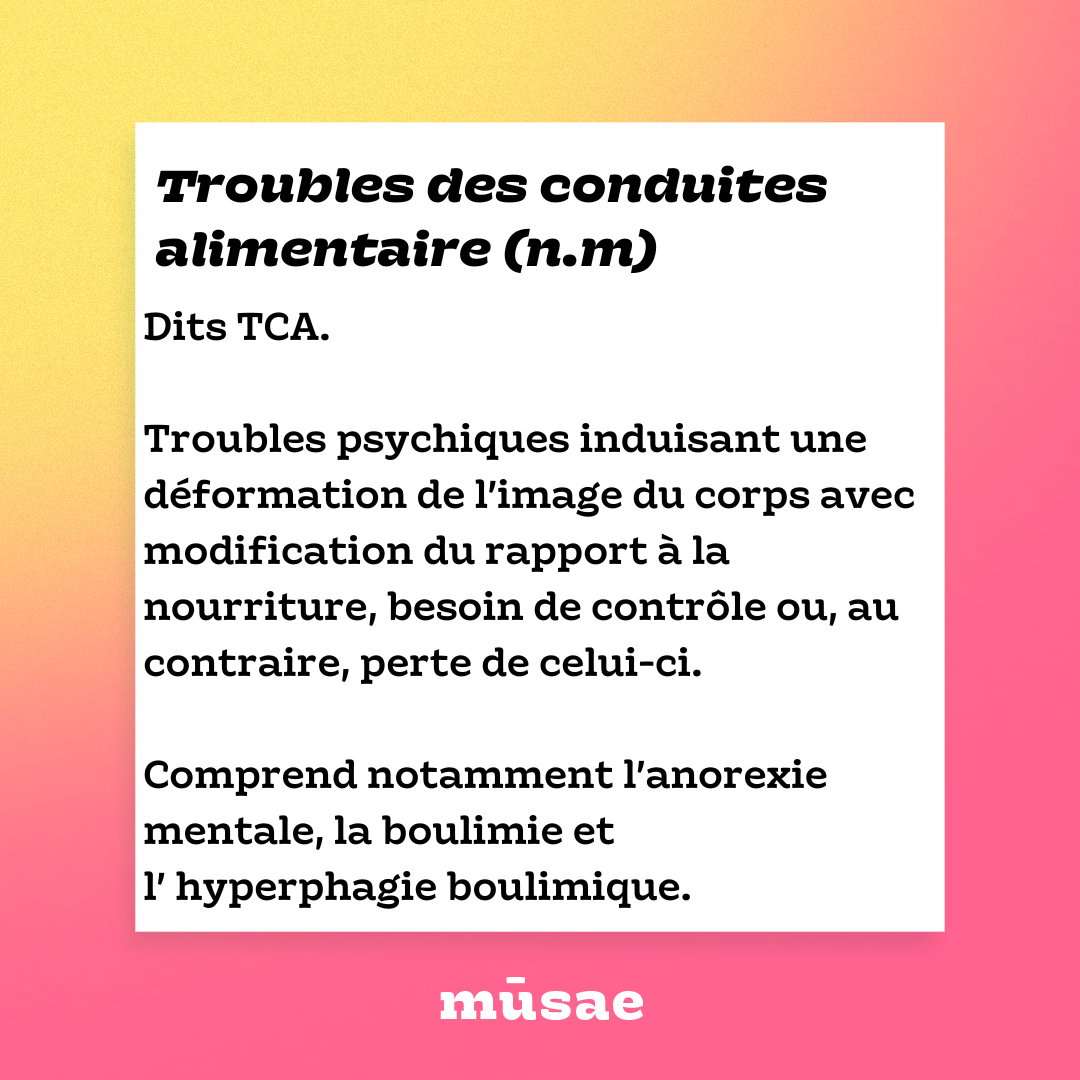
Anaïs Nighoghossian : Je pourrais dire la même chose. Je pense que les thérapies cognitives et comportementales m’ont donné des outils pour comprendre la manière dont contourner les situations ou les pensées obsessionnelles au quotidien. Mais il ne faut pas se leurrer, c’est un exercice qui s’inscrit dans la durée. Dans l’intervalle, ça n’empêche pas à la crise d’angoisse d’advenir. Pour pouvoir la juguler et mettre ses émotions à distance, je prends un antidépresseur depuis 3 ans au quotidien. Sans quoi le processus aurait été encore plus long et plus laborieux. Je ne fais pas l’apologie des psychotropes mais ça va de pair. Ça vous aide à avoir la disponibilité d’esprit requise pour pouvoir faire le travail.
Là où je rejoins aussi Mickaël c’est l’importance de la qualité de la relation avec sa/son professionnel·le de santé mentale. Et elle peut évoluer avec le temps. Pour ma part, après mon hospitalisation à Sainte-Anne, j’étais suivie par l’une des psychiatres qui officie à l’hôpital de jour. Elle m’a accompagné pendant 2 ans. C’était quelqu’un qui avait une posture très analytique. J’ai adhéré à sa manière de faire pendant les deux premières années parce que j’avais besoin de discipline. Je devais écrire dans mon carnet alimentaire tous les jours, lui apporter toutes les semaines et on le décortiquait ensemble. Elle me pesait. Mais 2 ans après, j’avais besoin d’autres choses. Je me sentais relativement libre et apaisée, je m’étais affranchie de pas mal de choses. J’avais besoin de retour, de conversation, de questionnement. Cette personne conservait la même approche, comme si j’étais la patiente du jour 0. À ce moment-là, je me suis sentie dévalorisée, alors que j’avais besoin de me sentir encouragée. Deux ans plus tard, rentrer chez votre psy qui vous dit « oh vous avez encore maigri » et je lui réponds « non docteur », puis elle me dit « on va vérifier, montez sur la balance »… Vous rentrez dans ce genre de rapport, ça n’est plus du soin. J’ai préféré changer. Aujourd’hui, je suis suivie par une autre psychiatre de Sainte-Anne, qui a une approche très différente avec laquelle je m’y retrouve. On ne parle plus de troubles alimentaires ou d’anorexie, elle ne me pèse plus, elle me fait confiance, elle m’encourage. Je pense que maintenant que j’ai franchi le plus dur, on peut construire. On peut affronter d’autres choses. Car il n’y a pas que les schémas d’ordre alimentaire à casser, il y en a de nombreux autres, comme les schémas affectifs. Aujourd’hui, je m’attaque à ce chantier-là, maintenant que les bases sont saines.
Je rejoins aussi Mickaël pour dire qu’il y a une santé à deux vitesses. Le psychiatre dont je vous parle n’est pas conventionné. Sur une consultation à 120 euros, la sécu me rembourse 8 euros et ma mutuelle, 2 euros. C’est injuste mais je ne peux pas en faire l’économie.
EN TERMES D’ACCESSIBILITÉ, IL Y A BEAUCOUP DE CHOSES À REDIRE. LE RÉTABLISSEMENT C’EST UN PROCESSUS SUR LE LONG-TERME. IL FAUT ACCEPTER QUE ÇA PRENNE DU TEMPS. ON VA ANALYSER COUCHE PAR COUCHE : LE RAPPORT AUX ALIMENTS, AU CORPS, AUX AUTRES. J’AIMERAIS QU’ON ABORDE CE DERNIER POINT.
QUEL EST NOTRE RAPPORT AUX AUTRES LORSQUE L’ON SOUFFRE D’ANOREXIE MENTALE ?
Mickaël Worms-Ehrminger : De mon côté, et je pense que c’est le cas pour pas mal de personnes, il y a un isolement qui s’est fait progressivement. Je me suis pas mal recentré sur moi-même car voir des gens signifiait aller au restaurant ou au bar et donc consommer des calories. J’étais dans un état d’esprit tellement noir, que je n’avais même pas envie de voir des gens. La seule chose qui me préoccupait était la nourriture, mon poids, mon corps. Ça me prenait toutes mes ressources mentales.
Mais plus on s’isole, plus on a tendance à aggraver ses troubles anxieux et dépressifs. On a l’impression que ça peut nous faire du bien, que ça permet de plus contrôler son poids. En réalité, c’est de pire en pire. Il n’y a personne qui est là pour voir qu’on se dégrade. Et c’est peut-être ce qu’on cherche un peu. On ne veut plus que les gens nous disent « tu es en train de maigrir, il faut que tu fasses attention ». On ne veut pas l’entendre car on est nous-mêmes dans le déni. Parce qu’on pense que notre corps est parfait. Mon isolement était donc choisi pour ne plus avoir à supporter ces paroles.
Ce qui m’a justement aidé, c’est de sociabiliser à nouveau, de partager des moments, des histoires, des émotions et des repas. C’est comme ça qu’aller au restaurant est (re)devenu un truc cool. Ça rétablit un contact positif avec la nourriture.
![]()
C’est la loi de l’omerta cette maladie. C’est l’éléphant au milieu de la pièce dont personne ne veut parler, on ne trouve pas les mots pour pouvoir l’aborder.
Anaïs Nighoghossian.
C’EST SOUVENT LE CAS DANS LA SANTÉ MENTALE. L’ISOLEMENT SOCIAL, C’EST CE QU’IL Y A DE PIRE. ANAÏS, DANS TON LIVRE TU EXPLIQUES QUE LES PERSONNES QUE TU RENCONTRES À L’HÔPITAL OU DANS LES GROUPES DE PAROLE SONT SOUVENT DES PERSONNES QUI SOUFFRENT D’UNE PROFONDE SOLITUDE.
Anaïs Nighoghossian : Oui, j’en ai vu beaucoup dans cet état-là. En ce qui me concerne, je ne me suis jamais complètement isolée ou alors, je m’isolais d’une autre manière. Pendant des années, je me suis contentée de relations très superficielles, pour ne pas avoir à aborder cette question-là. Je me réfugiais dans des milieux, avec des personnes qui, parfois, pouvaient partager d’autres addictions. Je savais qu’on ne rentrerait pas dans des sujets un peu deep. C’étaient des gens avec qui je pouvais avoir des aventures très passagères. Je n’ai pas particulièrement creusé les relations avec des proches, que j’ai revus beaucoup plus tard après ma thérapie. Avec la famille, c’est la défiance, la distance et le conflit qui s’installent. C’est la loi de l’omerta cette maladie. C’est l’éléphant au milieu de la pièce dont personne ne veut en parler, on ne trouve les mots pour pouvoir l’aborder.
C’EST VRAI QUE NOS PROCHES PEUVENT SE SENTIR DÉMUNIS FACE À LA MALADIE MENTALE. IELS N’ONT PAS FORCÉMENT LE BON MOT, LA BONNE RÉACTION, LE BON SOUTIEN. IELS PEUVENT PROJETER DES CHOSES SUR VOUS, LEUR ÉCHEC PERSONNEL, LEUR RELATION AVEC VOUS.
EST-CE QUE VOUS PENSEZ QUE TOU·TE·S NOS PROCHES PEUVENT ÊTRE PAIR-AIDANT·E·S EN SANTÉ MENTALE ?
Anaïs Nighoghossian : Au fil du temps, j’ai peut-être nourri une pensée radicale vis-à-vis de ça. Après avoir épuisé mes ressources plus ou moins proches pendant des années, sans réussir à me faire comprendre, je pense qu’il est vain de croire que la solution se trouve chez les autres et vos proches. Iels ne sont pas équipé·e·s. J’ai un père qui est professeur de médecine et neurologue. On pourrait se dire qu’il en connaît un paquet sur le dossier, mais en réalité pas du tout parce qu’il était incapable de deviner ce qu’il se passait à l’intérieur de moi. Avant la lecture de mon livre. Iels étaient démuni·es, se sentaient très coupables. Généralement, les relations et les situations avec nos proches deviennent violentes et conflictuelles parce qu’on n’est plus à même de se parler. Je ne suis pas en train de les décharger ou de les dédouaner. La seule responsabilité d’un parent, sans doute, c’est d’aimer son enfant de façon inconditionnelle. Comme me l’a toujours dit mon père, je sais qu’il sera toujours là, par la pensée, par des messages, des petits mots, un câlin, un réconfort mais ça s’arrêtera là.
Il ne faut pas attendre que la solution vienne de nos proches et accepter qu’ils ont une limite. On n’obtient pas sur commande leur disponibilité émotionnelle. De la même manière que, si aujourd’hui certain·es viennent me demander de l’aide ou si on s’attend à ce que je sois un recours pour aider quelqu’un·e qui souffre de TCA, je ne vais pas pouvoir. J’ai ma limite et j’assume de le dire. Je suis une témoin, rien de plus.
La solution n’est pas chez les autres. Je suis admirative des patient·es qui arrivent à trouver des ressources en elleux et seul·e·s, surtout quand leurs expériences avec des professionnel·le·s de santé ont été décevantes. Moi, je ne l’ai pas réussi seule. La seule chose dont je peux témoigner, ce que j’ai réussi, c’est avec l’aide de professionnel·le·s.
Mickaël Worms-Ehrminger : Je rejoins tout à fait ce qu’Anaïs dit. On peut mettre un peu en parallèle avec la relation que l’on fait entre santé mentale et santé physique. Quand on a un cancer, on peut aller en parler si la personne est disposée à parler de maladies graves, potentiellement mortelle et de souffrances. Mais la personne en face peut aussi avoir perdu son père ou sa mère d’un cancer quelques mois plus tôt et elle ne va pas être en mesure d’entendre parler quelqu’un·e de son cancer. C’est pareil avec la santé mentale. On a tellement l’impression que ce sont des faiblesses de caractère, qu’il suffit d’aller voir quelqu’un·e pour lui en parler et penser que l’on va aller mieux. Ce dont on ne se rend pas forcément compte, c’est que ce sont des « vraies maladies ». Elles nécessitent une prise en charge de santé, par des médecins, des psychologues, des diététiciens, par toute l’équipe qui peut intervenir dans le cadre des TCA par exemple. Le plaidoyer que j’ai est que mes proches peuvent être un soutien s’iels sont capables de le faire et s’iels ont la volonté de le faire. Tout le monde n’est pas outillé pour entendre de la souffrance qui peut être extrême. C’est vraiment le rôle des professionnel·le·s. L’entourage peut être un soutien quand c’est possible et quand c’est souhaité. C’est vrai que c’est surtout les professionnel·le·s qui aident, quand iels ne sont pas décevant·e·s. La psychiatrie, ce n’est pas comme aller chez un pneumologue car qu’il soit con ou sympa, ça ne change rien. Alors que si tu tombes sur un·e psychiatre avec qui tu ne t’entends pas, ça va faire une grosse partie de la thérapie. C’est ce qu’on appelle l’alliance thérapeutique. Je pense que le mieux est de trouver le ou la bon·ne professionnel·le et éventuellement les proches en soutien, si souhaité.

Mickaël Worms-Ehrminger, docteur en santé publique et recherche clinique, se livre dans cet ouvrage sur ses différentes troubles psychiques afin de lever le tabou sur les troubles de santé mentale. En partant de son expérience, mais aussi des personnes reçues dans son podcast Les maux bleus, il revient sur de nombreux sujets : errance médicale, incompréhension de l’entourage, sentiment de honte, déni, risque suicidaire.
Dans ce témoignage, Anaïs Nighoghossian se livre sans tabou sur son combat quotidien contre l’anorexie. Elle livre une réflexion nécessaire sur les troubles des conduites alimentaires et leurs impacts. En retraçant son parcours depuis l’apparition de la maladie, aux expériences de soin qu’elle a vécu, elle interroge les mécanismes qui fabriquent l’anorexie.

| 3018, numéro vert contre le cyber-harcèlement Le 3114, souffrance prévention suicide En avant toute(s), tchat de soutien pour les personnes victimes de violences Le Psycom |